Dispositif lesson study à l'école maternelle : ajustements, projections et développements
Lesson study in preschool: adjustments, projections and developments
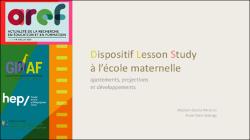
Type de référence
Date
2025-07-09Langue de la référence
FrançaisEntité(s) de recherche
Résumé
En Suisse, l’entrée en vigueur en 2006 de l’Harmonisation scolaire au niveau fédéral est venue requestionner un certain nombre d’éléments dans le paysage éducatif romand, notamment concernant l’entrée dans la scolarité se faisant dès lors obligatoirement dès 4 ans. Ce changement politique s’étant répercuté au niveau des prescriptions avec l’apparition de nouveaux plans d’études par région linguistique, de nouvelles questions ont émergé tant du côté du personnel enseignant du cycle 1 (4 à 8 ans) que de celui des formateurs et chercheurs œuvrant notamment à la formation de ces professionnels. Ainsi, le jeu ayant disparu des documents officiels, et la grille horaire des jeunes élèves étant pensée dans une logique de découpage disciplinaire laissant assez peu de place aux activités initiées par les élèves, la place et le rôle du jeu de faire semblant en tant qu’activité essentielle et modalité de travail semblait vouée à être repensé (Clerc-Georgy & Kappeler, 2020).
C’est dans un tel contexte qu’ont vu le jour un certain nombre de projets de formation et/ou de recherche à la Haute École Pédagogique Vaud (HEP Vaud) pour traiter de ces questions au niveau romand . Un CAS dédié aux spécificités des apprentissages des jeunes enfants a été créé, des formations continues en s’inspirant du modèle Lesson Study (LS) ont été mis en œuvre, ainsi que deux projets de thèse ayant impliqué dans leur dispositif de recherche un dispositif de LS, tous au sein du groupe Intervention et Recherche sur les Apprentissages Fondamentaux (GIRAF). Par ailleurs, l’inauguration en 2014 d’un Laboratoire Lausannois Lesson Study (3LS) au sein de la HEP Vaud a marqué l’ambition pour l’institution de participer à l’étude ainsi qu’à la diffusion de ce dispositif en francophonie, bien plus connu et répandu au Japon, aux Etats-Unis ainsi qu’au Nord de l’Europe. L’usage que les chercheur-e-s romand-e-s font de la démarche se veut souple, respectant les éléments essentiels de la LS en favorisant la collaboration entre chercheurs et praticiens, tout en partant des préoccupations du terrain. C’est ainsi qu’une adaptation du dispositif non seulement à l’objet d’étude – à savoir les spécificités d’apprentissage des jeunes enfants pouvant s’appuyer sur le jeu et les activités initiées par les enfants dans notre cas précis – et aux contraintes plus spécifiques au groupe de participants a été réfléchie. En effet, à notre connaissance, les travaux menés à l’international dans le cadre de LS, le font essentiellement à partir d’activités initiées par les enseignant-e-s, mettant de fait de côté les activités initiées par les élèves. Bien que les expériences de lesson studies menées plus spécifiquement en contexte préscolaire, (ou auprès d’enfants âgés entre 4 et 8 ans) soient peu nombreuses, les quelques études ayant fait l’objet de publications internationales présentent des résultats prometteurs pour l’adaptation des LS au contexte préscolaire (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander, 2013 ; Lindstrand, Hansson, Olsson & Ljung-Djärf, 2016).
Dans le cadre d’un des projets de thèse du GIRAF, portant sur la transition vers l’école, un dispositif de LS impliquant cinq enseignant-e-s volontaires et deux chercheuses spécialistes des apprentissages fondamentaux a ainsi été déployé pendant une année scolaire. Autour des différents cycles de LS, des enregistrements vidéo de moments de jeu en classe ainsi que des moments d’échanges avec les enseignant-e-s ont été réalisés à la fois en amont, pendant, et en aval de la LS. Si les cinq entretiens de fin d’année avec les enseignant-e-s ont bien permis de recueillir des informations relatives à l’objet d’étude central de la thèse, ils fournissent également un aperçu sur la manière dont ces derniers ont vécu le dispositif. L’analyse narrative (Riessman, 1993, Patterson, 2008) conduite sur les entretiens ayant précédé et suivi la LS (N=10) ont notamment mis en évidence la présence de clauses évaluatives de type comparatif, ainsi que de blocs narratifs de l’ordre de la projection dans le futur.
La communication présentera dans un premier temps les modalités d’adaptation originales du dispositif LS aux spécificités des premiers degrés de la scolarité, et plus particulièrement aux activités peu « anticipables », ainsi qu’aux contraintes du contexte et des participant-e-s. Dans un second temps, les résultats des analyses narratives seront mobilisés afin de révéler les types de projections émises par les enseignant-e-s de l’ordre de l’alternative ou du futur hypothétique en début et en fin d’année. Dans un troisième temps, des pistes de développement du dispositif LS adapté aux premiers degrés de la scolarité permettant à la fois de répondre aux exigences en termes d’apprentissages disciplinaires et aux difficultés rencontrées par les enseignants seront discutées.
Résumé traduit en anglais
In Switzerland, the entry into force in 2006 of federal school harmonisation called into question a number of aspects of the educational landscape in French-speaking Switzerland, particularly with regard to compulsory schooling from the age of four. This policy change was reflected in the regulations with the introduction of new curricula for each language region, raising new questions among both Cycle 1 teaching staff (ages 4 to 8) and the trainers and researchers involved in training these professionals. Thus, with play having disappeared from official documents and the timetable for young pupils being designed according to a disciplinary structure that leaves little room for pupil-initiated activities, the place and role of pretend play as an essential activity and working method seemed destined to be rethought (Clerc-Georgy & Kappeler, 2020). It was in this context that a number of training and/or research projects were launched at the Haute École Pédagogique Vaud (HEP Vaud) to address these issues in French-speaking Switzerland. A CAS dedicated to the specificities of early childhood learning was created, continuing education courses inspired by the Lesson Study (LS) model were implemented, and two thesis projects involving an LS approach were carried out, all within the Intervention and Research on Fundamental Learning (GIRAF) group. Furthermore, the inauguration in 2014 of a Lausanne Lesson Study Laboratory (3LS) within the HEP Vaud marked the institution's ambition to participate in the study and dissemination of this approach in French-speaking countries, which is much better known and more widespread in Japan, the United States and Northern Europe. The approach used by researchers in French-speaking Switzerland is intended to be flexible, respecting the essential elements of LS by promoting collaboration between researchers and practitioners, while taking into account the concerns of those working in the field. Thus, consideration was given to adapting the approach not only to the subject of study – namely, the specific learning characteristics of young children that can be supported by play and child-initiated activities in our specific case – but also to the more specific constraints of the group of participants. To our knowledge, international LS studies are mainly based on activities initiated by teachers, effectively sidelining activities initiated by pupils. Although there are few lesson study experiences conducted specifically in a preschool context (or with children aged between 4 and 8), the few studies that have been published internationally show promising results for the adaptation of LS to the preschool context (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander, 2013; Lindstrand, Hansson, Olsson & Ljung-Djärf, 2016). As part of one of GIRAF's thesis projects on the transition to school, an LS programme involving five volunteer teachers and two researchers specialising in basic learning was implemented over the course of one school year. Throughout the various LS cycles, video recordings of classroom playtime and discussions with teachers were made before, during and after the LS. While the five end-of-year interviews with teachers provided information relevant to the central subject of the thesis, they also gave an insight into how the teachers experienced the programme. The narrative analysis (Riessman, 1993, Patterson, 2008) conducted on the interviews that preceded and followed the LS (N=10) highlighted the presence of comparative evaluative clauses, as well as narrative blocks relating to projections into the future. The presentation will first outline the original ways in which the LS programme was adapted to the specific characteristics of early schooling, particularly to activities that are difficult to anticipate, as well as to the constraints of the context and the participants. Secondly, the results of the narrative analyses will be used to reveal the types of projections made by teachers in terms of alternatives or hypothetical futures at the beginning and end of the year. Thirdly, avenues for developing the LS system adapted to the early stages of schooling, enabling both the requirements in terms of subject learning and the difficulties encountered by teachers to be met, will be discussed.Nom de la manifestation
Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation (AREF)Date(s) de la manifestation
du 7 au 9 juillet 2025Ville de la manifestation
LiègePays de la manifestation
BelgiquePortée de la manifestation
internationaleURL permanente ORFEE
http://hdl.handle.net/20.500.12162/8548Document(s) associé(s) à la référence
Autre(s) document(s) :
Fichier
Accès
Commentaire
Taille
- Tout ORFEE
- Détail référence



